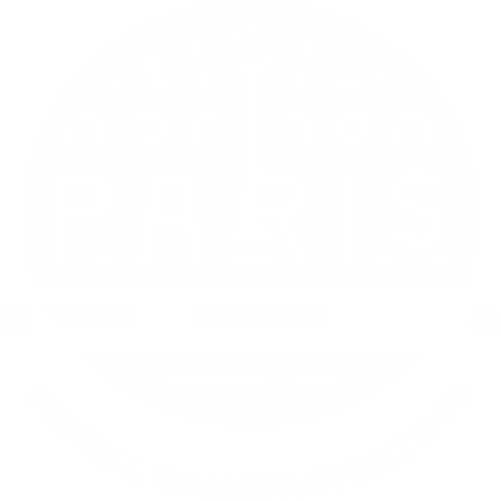Face à la recrudescence des cyberattaques, l’enjeu n’est plus seulement technique mais aussi communicationnel. En 2025, le temps de réaction devient un facteur déterminant pour contenir la crise et préserver la réputation de l’organisation. Les attaques informatiques ayant quadruplé ces dernières années, aucune structure n’est désormais à l’abri, qu’il s’agisse d’entreprises privées ou d’organismes publics. Pourtant, la communication reste souvent le parent pauvre de la gestion de crise cyber, reléguée à une simple notification. Les organisations qui excellent dans ce domaine sont celles qui intègrent dès les premières heures un protocole structuré, permettant de déployer une communication maîtrisée en moins de 48 heures. Cette approche proactive, loin d’être accessoire, devient un élément stratégique pour traverser la tempête d’une cyberattaque en préservant la confiance des parties prenantes et en minimisant les dommages collatéraux sur l’image et l’activité.
Constituer et mobiliser votre cellule de crise cyber en urgence
Dans le contexte d’une cyberattaque, la rapidité et l’efficacité de la mobilisation des équipes constituent le premier facteur de réussite. En 2025, la constitution d’une cellule de crise cyber n’est plus une option mais une nécessité absolue pour toute organisation. Cette équipe pluridisciplinaire doit pouvoir être opérationnelle en quelques heures seulement pour faire face à la menace et coordonner la communication interne et externe.
La composition de cette cellule est déterminante pour son efficacité. Elle doit impérativement inclure des représentants de la direction générale, du service informatique, du service juridique, des ressources humaines et bien évidemment du département communication. Pour les organisations de taille importante, des experts de Orange Cyberdefense ou Thales peuvent être intégrés comme consultants externes pour apporter une expertise technique pointue et une vision objective de la situation.

Définir les rôles et responsabilités dans l’urgence cybernétique
La clarification des rôles au sein de la cellule de crise doit être établie bien avant qu’une attaque ne survienne. Cependant, même si ce travail préparatoire n’a pas été réalisé, il est impératif de le faire dans les premières heures suivant la détection de l’incident. La désignation d’un coordinateur principal est essentielle – généralement un membre de la direction disposant de l’autorité nécessaire pour prendre des décisions stratégiques.
Le directeur des systèmes d’information (DSI) ou le responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) jouera le rôle d’expert technique, tandis que le responsable communication agira comme chef d’orchestre des messages diffusés. Cette structure doit être formalisée dans un document accessible, même en cas de défaillance des systèmes informatiques habituels.
| Fonction | Responsabilités | Délai d’action |
|---|---|---|
| Coordinateur de crise | Prise de décision stratégique, validation des communications officielles | Immédiat (H+1) |
| Expert technique (DSI/RSSI) | Évaluation technique de l’incident, supervision des mesures correctives | Immédiat (H+1) |
| Responsable communication | Élaboration et diffusion des messages, coordination avec la presse | H+2 maximum |
| Juriste | Évaluation des obligations légales (RGPD, notifications obligatoires) | H+3 maximum |
| RH | Communication interne, gestion des inquiétudes des collaborateurs | H+4 maximum |
L’activation du protocole de crise doit suivre un processus clairement défini. La première étape consiste à établir un canal de communication alternatif, indépendant des systèmes potentiellement compromis. Des solutions comme des plateformes sécurisées proposées par Stormshield ou des systèmes de messagerie chiffrée peuvent être déployées pour assurer la continuité des échanges au sein de la cellule de crise.
La mise en place d’une salle de crise physique ou virtuelle constitue également une priorité. Cette “war room” centralisera toutes les informations et facilitera la prise de décision rapide. Elle doit être équipée des outils nécessaires pour suivre l’évolution de la situation en temps réel et permettre des réunions fréquentes de mise à jour.
Premiers réflexes communicationnels face à une cyberattaque
Dans les 12 premières heures suivant la détection d’une cyberattaque, plusieurs actions de communication doivent être entreprises simultanément. Elles constituent la fondation de toute la stratégie de communication qui suivra et permettront d’éviter les écueils classiques d’une gestion de crise improvisée.
La première étape consiste à établir un état des lieux précis de la situation, en collaboration avec les experts techniques comme ceux de Wavestone ou Capgemini. Il est crucial de déterminer : la nature de l’attaque, les systèmes touchés, les données potentiellement compromises, et l’impact sur l’activité de l’organisation. Ce diagnostic initial, même s’il reste incomplet, servira de base aux premières communications.
- Prioriser les cibles de communication : identifier les parties prenantes critiques (dirigeants, collaborateurs, clients, partenaires, autorités) à informer en priorité
- Sécuriser les canaux de diffusion : s’assurer que les moyens de communication utilisés ne sont pas compromis
- Préparer des messages-types : rédiger des modèles de communiqués adaptables selon l’évolution de la situation
- Désigner un porte-parole unique : centraliser la communication officielle pour éviter les contradictions
- Mettre en place une veille active : surveiller les réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias
La communication interne doit être traitée avec une attention particulière. Les collaborateurs sont à la fois des cibles potentielles de l’attaque (via le phishing par exemple) et des vecteurs d’information vers l’extérieur. Un message clair et responsable doit leur être adressé, incluant les consignes de sécurité à suivre et les comportements à adopter pour ne pas aggraver la situation.
La notification aux autorités compétentes fait également partie des premiers réflexes à avoir. En France, l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) et la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) doivent être informées dans des délais précis, surtout en cas de compromission de données personnelles. La plateforme Cybermalveillance.gouv.fr constitue également un point de contact important pour les organisations touchées.
Élaborer une stratégie de communication transparente mais maîtrisée
Face à une cyberattaque, la transparence s’impose comme un impératif, mais elle doit être soigneusement calibrée. Une communication totalement ouverte pourrait exposer des vulnérabilités exploitables par les attaquants, tandis qu’un mutisme complet alimenterait les rumeurs et saperait la confiance. L’équilibre réside dans une stratégie de communication transparente mais maîtrisée, développée et affinée dans les 24 à 48 heures suivant la découverte de l’incident.
Cette stratégie doit s’articuler autour de plusieurs principes fondamentaux. En premier lieu, l’honnêteté : reconnaître l’existence de l’attaque sans minimiser sa gravité ni l’amplifier inutilement. Ensuite, la précision : communiquer uniquement sur des faits vérifiés, en évitant les suppositions hasardeuses. Enfin, la progressivité : délivrer l’information par étapes, au fur et à mesure que la situation se clarifie, sans précipitation ni rétention injustifiée.

Construire des messages adaptés à chaque public cible
Une communication de crise efficace exige une différenciation claire des messages selon les publics visés. Chaque partie prenante a des préoccupations spécifiques qui doivent être adressées de manière personnalisée, tout en maintenant une cohérence globale dans le discours. L’élaboration de ces messages différenciés constitue une tâche prioritaire pour le responsable communication, en collaboration avec les experts de Atos ou Sopra Steria si nécessaire.
Pour les clients et usagers, l’accent doit être mis sur l’impact concret de l’incident sur les services, les mesures de protection de leurs données et les délais de retour à la normale. Le ton doit être rassurant mais réaliste, sans promesses impossibles à tenir. Un exemple de message pourrait être : “Nos équipes, renforcées par des experts de Orange Cyberdefense, travaillent 24h/24 pour rétablir vos services prioritaires. Vos données personnelles font l’objet d’une surveillance spécifique et aucune compromission n’a été détectée à ce stade.”
La communication aux collaborateurs requiert davantage de détails techniques sur les systèmes affectés et les procédures d’urgence à suivre. Elle doit également aborder les questions pratiques comme l’organisation du travail pendant la crise, sans perturber l’équilibre de l’entreprise. Un canal dédié aux questions-réponses internes peut être mis en place, par exemple via une FAQ régulièrement mise à jour ou des sessions d’information quotidiennes.
Pour les actionnaires et partenaires financiers, l’accent sera mis sur l’évaluation des risques économiques, la continuité des activités critiques et la solidité des dispositifs de réponse à l’incident. La communication doit être factuelle et précise, en évitant tout jargon technique superflu mais sans simplification excessive des enjeux.
- Médias et grand public : communiqués concis, factuels, contextualisant l’incident dans l’écosystème cyber actuel
- Autorités de régulation : rapports détaillés conformes aux obligations légales (RGPD, LPM, NIS2)
- Partenaires commerciaux : information sur les interfaces concernées et mesures de mitigation
- Fournisseurs : directives spécifiques concernant les accès et procédures modifiés
- Écosystème sectoriel : partage d’indicateurs de compromission pour prévenir la propagation
La coordination de ces différents messages nécessite un planning éditorial rigoureux. Un tableau de bord de communication de crise doit être maintenu à jour, recensant tous les messages diffusés, leurs destinataires, leurs canaux de diffusion et leur fréquence de mise à jour. Cette centralisation de l’information communicationnelle permet d’éviter les contradictions et les oublis.
Choisir les canaux de diffusion appropriés en situation d’urgence
En situation de cyberattaque, les canaux de communication habituels peuvent être compromis ou inaccessibles. La sélection des vecteurs de diffusion devient donc un enjeu stratégique majeur. Cette réflexion doit être menée dès la première journée de crise, en tenant compte des contraintes techniques spécifiques à l’incident en cours.
Les canaux numériques propres à l’organisation (site web, intranet, applications mobiles) constituent généralement le premier choix pour diffuser l’information officielle. Cependant, ils peuvent être directement affectés par l’attaque. Des solutions de repli doivent être prévues, comme un site web de crise hébergé sur une infrastructure distincte, préconfiguré par des prestataires comme Econocom ou Itrust.
| Canal de communication | Avantages en situation de crise | Limites potentielles |
|---|---|---|
| Site web de crise dédié | Contrôle total du message, point d’information central | Nécessite une préparation technique préalable |
| Réseaux sociaux d’entreprise | Réactivité, large audience, possibilité de dialogue | Risque de désinformation, nécessite une modération active |
| Messagerie SMS/Téléphonie | Indépendance vis-à-vis des systèmes informatiques | Messages courts, coûteux pour grandes audiences |
| Relations presse | Crédibilité, large diffusion | Délais de publication, risque d’interprétation |
| Communication physique | Fiabilité totale, indépendance technique | Couverture géographique limitée, lenteur |
Les réseaux sociaux jouent un rôle ambivalent en situation de crise cyber. D’un côté, ils permettent une diffusion rapide et large de l’information officielle. De l’autre, ils constituent un terrain propice aux rumeurs et à la désinformation. Une stratégie de communication sur les réseaux sociaux d’entreprise en situation de crise doit inclure une veille renforcée et une capacité de réaction immédiate aux fausses informations.
Pour la communication interne, des systèmes alternatifs doivent être déployés si l’infrastructure habituelle est compromise. Des applications de messagerie sécurisées sur smartphones personnels, des lignes téléphoniques dédiées ou même des points d’information physiques peuvent être mis en place. L’essentiel est de maintenir un flux d’information constant vers les collaborateurs pour éviter les initiatives individuelles non coordonnées.
La communication avec les autorités et organismes réglementaires mérite une attention particulière. Des canaux sécurisés et officiels doivent être privilégiés, conformément aux procédures établies par l’ANSSI et la CNIL. La documentation des échanges avec ces instances est cruciale, tant pour des raisons de traçabilité que pour démontrer la bonne foi de l’organisation dans sa gestion de l’incident.
Enfin, la relation avec les médias traditionnels doit être structurée et professionnalisée. Plutôt que de subir l’agenda médiatique, l’organisation doit prendre l’initiative via des relations presse proactives. Des points presse réguliers, des interviews contrôlées et des communiqués officiels permettent de maîtriser le narratif public autour de l’incident.
Gérer l’évolution de la crise : adaptation et réactivité communicationnelle
Une cyberattaque n’est jamais un événement statique mais un processus dynamique dont l’intensité et la nature évoluent au fil des heures et des jours. La communication de crise doit refléter cette évolution, s’adapter aux nouvelles informations et anticiper les changements de perception. Cette dimension temporelle représente un défi majeur pour les équipes de communication, souvent habituées à des cycles plus longs d’élaboration et de validation des messages.
La mise en place d’un système de veille multidimensionnelle constitue la colonne vertébrale de cette réactivité. Il s’agit de surveiller simultanément l’évolution technique de l’incident, les réactions des différentes parties prenantes et le traitement médiatique de la crise. Cette veille permet d’identifier rapidement les inflexions nécessaires dans la stratégie de communication et d’anticiper les nouvelles problématiques émergeantes.

Anticiper les différentes phases de la crise cyber et leurs enjeux communicationnels
Une crise cyber suit généralement un schéma prévisible, composé de plusieurs phases distinctes qui appellent chacune une approche communicationnelle spécifique. La compréhension de ce cycle permet d’anticiper les besoins informationnels futurs et de préparer les messages en conséquence, même dans l’urgence des premières 48 heures.
La phase initiale, celle de la découverte et de la confirmation de l’attaque, exige une communication factuelle et prudente. Les messages doivent reconnaître l’existence d’un incident sans en surestimer ni sous-estimer la gravité. C’est également le moment de mobiliser les expertises externes comme celles de Wavestone ou Itrust pour renforcer la crédibilité du discours technique.
Vient ensuite la phase d’évaluation approfondie, généralement 12 à 24 heures après la détection initiale. À ce stade, la communication doit s’enrichir de détails techniques validés, présenter les premières mesures correctives et donner des indications plus précises sur l’impact opérationnel. Un message type pourrait être : “L’analyse menée avec nos partenaires de Thales a permis d’identifier précisément les systèmes affectés. Les services A, B et C demeurent temporairement indisponibles, tandis que les services X, Y et Z fonctionnent normalement.”
- Phase 1 (H+0 à H+12) : Communication factuelle, reconnaissance de l’incident, mobilisation visible
- Phase 2 (H+12 à H+24) : Détails techniques validés, impact précisé, premières mesures correctives
- Phase 3 (H+24 à H+36) : Plan de résolution, perspective temporelle, mesures d’accompagnement
- Phase 4 (H+36 à H+48) : Bilan intermédiaire, calendrier de rétablissement, dispositif de suivi
- Phase 5 (au-delà de H+48) : Communication sur les enseignements, mesures préventives futures
La troisième phase, généralement 24 à 36 heures après le début de la crise, est celle de la stabilisation et de la planification. La communication doit alors se concentrer sur le plan de résolution, offrir une perspective temporelle crédible et détailler les mesures d’accompagnement pour les utilisateurs affectés. C’est également le moment de communiquer avec transparence sans provoquer d’inquiétude excessive sur les défis qui persistent.
La quatrième phase, entre 36 et 48 heures après le début de l’incident, permet de dresser un premier bilan intermédiaire et de présenter un calendrier de rétablissement plus détaillé. La communication doit mettre en avant les progrès réalisés tout en restant réaliste sur les défis qui subsistent. C’est également le moment d’annoncer le dispositif de suivi qui sera mis en place pour la phase de résolution complète, potentiellement plus longue.
Au-delà des 48 premières heures, la communication entre dans une phase plus réflexive, abordant les enseignements tirés de l’incident et les mesures préventives qui seront mises en place pour l’avenir. C’est le moment de reconstruire la confiance en démontrant que l’organisation a tiré les leçons appropriées de cette épreuve, par exemple en annonçant un partenariat renforcé avec des acteurs comme Orange Cyberdefense ou Capgemini.
Adapter la posture communicationnelle selon l’évolution technique de l’incident
L’évolution technique d’une cyberattaque conditionne directement la posture communicationnelle à adopter. Une attaque en cours, une attaque contenue mais non résolue, ou une attaque maîtrisée mais ayant laissé des séquelles appellent des approches radicalement différentes. Cette adaptation constante exige une collaboration étroite entre les experts techniques et l’équipe de communication.
Lorsque l’attaque est encore active et que sa portée n’est pas totalement cernée, la communication doit adopter une posture défensive et prudente. L’accent est mis sur les mesures de protection immédiate et les consignes de vigilance. Les messages doivent être régulièrement actualisés pour refléter les nouvelles découvertes, sans tomber dans l’alarmisme ni dans la minimisation.
Dès que l’attaque est contenue mais que ses effets persistent, la posture communicationnelle peut évoluer vers un registre plus explicatif et pédagogique. C’est le moment de détailler les mécanismes de l’attaque (sans révéler d’informations sensibles qui pourraient être exploitées par d’autres acteurs malveillants), de présenter le plan de remédiation et d’expliquer les délais nécessaires au rétablissement complet.
- Attaque active non maîtrisée : communication défensive, centrée sur la protection immédiate
- Attaque contenue mais active : communication explicative sur les mesures techniques déployées
- Propagation stoppée mais effets persistants : communication focalisée sur le plan de restauration
- Restauration en cours : communication orientée sur les priorités et le calendrier
- Incident résolu avec séquelles : communication sur les mesures compensatoires et l’accompagnement
Lorsque la phase de restauration est bien engagée, la communication peut adopter une tonalité plus positive et proactive. Elle met alors l’accent sur les progrès réalisés, le calendrier de rétablissement des différents services et les priorités établies. Cette phase est également propice à l’explication des stratégies de communication futures concernant l’incident.
Enfin, une fois l’incident techniquement résolu mais laissant potentiellement des séquelles (données perdues, systèmes à reconstruire, etc.), la communication doit se concentrer sur les mesures compensatoires et l’accompagnement des utilisateurs affectés. C’est également le moment d’amorcer le récit de la résilience de l’organisation face à l’adversité, en préparation de la phase post-crise.
Cette adaptation constante requiert un dispositif de validation accéléré des messages. Des templates pré-approuvés pour chaque phase et chaque scénario peuvent être préparés en amont, puis simplement adaptés à la situation réelle. Des outils collaboratifs sécurisés, recommandés par des experts comme Stormshield, facilitent cette co-construction agile des messages entre les différentes expertises de la cellule de crise.
Préserver la réputation et rebondir : communication post-crise immédiate
Après les 48 premières heures d’une cyberattaque, bien que la crise technique puisse être encore en cours de résolution, une nouvelle phase communicationnelle s’amorce : celle de la préservation de la réputation et de la préparation du rebond. Cette étape est cruciale car elle conditionne la perception à long terme de l’incident par les parties prenantes et peut transformer une crise en opportunité de renforcement de la confiance.
La gestion de la réputation post-crise immédiate s’articule autour de plusieurs axes complémentaires. Il s’agit d’abord de contrôler le narratif autour de l’incident, en évitant que des interprétations erronées ou excessivement négatives ne s’installent dans l’espace public. Ensuite, il faut valoriser les actions positives entreprises pendant la crise, tant sur le plan technique que sur le plan de l’accompagnement des personnes affectées. Enfin, il est nécessaire de poser les jalons d’une communication de transformation, montrant comment l’organisation va évoluer suite à cette épreuve.
Établir un bilan communicationnel intermédiaire et ajuster la stratégie
À l’issue des 48 premières heures, un bilan communicationnel intermédiaire s’impose pour évaluer l’efficacité des messages diffusés et ajuster la stratégie pour les jours suivants. Ce bilan, réalisé par l’équipe communication en collaboration avec la direction générale et les experts techniques, permet d’identifier les forces et faiblesses de la communication déployée jusqu’alors.
L’analyse de la couverture médiatique constitue un premier indicateur précieux. Une revue systématique des articles, reportages et mentions sur les réseaux sociaux permet d’évaluer le ton général des commentaires, la précision des informations relayées et l’éventuelle présence de critiques récurrentes. Des outils de veille médiatique fournis par Atos ou d’autres prestataires spécialisés facilitent cette analyse exhaustive.
- Analyse quantitative : volume de mentions, évolution des sentiments exprimés, comparaison avec des crises similaires
- Analyse qualitative : précision des informations relayées, présence de critiques injustifiées, messages mal interprétés
- Feedback des parties prenantes : retours directs des clients, collaborateurs et partenaires sur la clarté des communications
- Efficacité des canaux : taux d’ouverture des emails de crise, audience des points d’information, engagement sur les réseaux sociaux
- Impact sur la réputation : évolution des indicateurs de confiance et de réputation par rapport à la période pré-crise
Le feedback direct des différentes parties prenantes constitue une autre source d’information précieuse. Des canaux dédiés doivent être mis en place pour recueillir les réactions des clients, collaborateurs et partenaires à la communication de crise. Ces retours permettent d’identifier les zones d’incompréhension ou d’insatisfaction qui nécessitent des clarifications supplémentaires.
Sur la base de ce bilan, des ajustements stratégiques peuvent être décidés pour la communication post-crise immédiate. Il peut s’agir de renforcer certains messages insuffisamment compris, de corriger des informations imprécises, ou d’adapter le ton général pour mieux répondre aux attentes émotionnelles des parties prenantes.
Cette phase d’évaluation doit également permettre d’identifier les porte-paroles les plus crédibles et efficaces, pour les mobiliser davantage dans les communications futures. L’expérience montre que la personnalisation des messages, portés par des figures identifiables et légitimes de l’organisation, renforce considérablement leur impact et leur acceptation.
Construire un récit de résilience et d’apprentissage organisationnel
Au-delà de la gestion technique de l’incident, la construction d’un récit cohérent autour de la cyberattaque représente un enjeu majeur pour l’avenir de l’organisation. Ce narratif doit transformer l’épreuve en opportunité d’apprentissage et démontrer la résilience organisationnelle, sans tomber dans l’autosatisfaction déplacée ou la victimisation excessive.
Ce récit de résilience s’articule autour de plusieurs éléments clés. D’abord, la reconnaissance honnête des vulnérabilités exploitées et des erreurs éventu